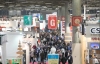Les résineux sont au centre du débat forestier : atout maître pour la production (80 % du volume de bois scié sur moins de 30 % de la surface boisée française), ils sont l’objet de contestations sociétales, tout en étant soumis aux changements globaux. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Avant d’appréhender l’avenir des résineux dans les forêts françaises, faisons un détour historique.
Histoire des résineux : des théories au débat sociétal
-
L’école allemande
La forêt française (comme partout en Europe) est sévèrement ponctionnée par l’Homme pour le bois de feu jusqu’au milieu du XIXe siècle, où elle ne couvre plus que la moitié de la surface actuelle. Elle est alors essentiellement constituée de taillis et taillis sous futaie feuillus dégradés. Cantonnés en montagne, les résineux n’ont d’intérêt que pour fournir des mâts de navires.
Les premières véritables théories sylvicoles apparaissent alors en Allemagne et vont influencer toute l’Europe. Il s’agit de constituer des peuplements réguliers résineux purs, denses, destinés à la coupe rase. Elles sont la base d’études économiques, avec l’idée que l’Homme peut dompter la nature en s’appuyant sur des lois physiques.
-
L’école française
Peu après, l’école de Nancy prône la conversion des taillis et taillis sous futaie en futaie régulière. Cette vision plus écologique se résume par l’adage « imiter la nature, hâter son œuvre ». L’éducation des peuplements par l’éclaircie sélective s’impose. Parallèlement, dans le Jura, se développe le jardinage cultural des résineux et la futaie d’âges multiples. De grands débats opposent alors « régularistes » et « jardiniers ».
-
L’ère du régulier
Après la Seconde Guerre mondiale, est lancé un vaste programme de boisements pour reconstruire le pays, s’appuyant sur des résineux indigènes (pin sylvestre, épicéa…) puis exotiques (douglas…). La sylviculture est simple : plantation et traitement en futaie régulière monospécifique, bien adaptée aux besoins de l’industrie.
À l’installation, on transpose certaines techniques de l’agriculture intensive, en plein essor (travail du sol, engrais, mécanisation, herbicides).
Parallèlement, l’amélioration génétique progresse (sélection de provenances, vergers à graines), mais rejette les OGM. Le massif de pin maritime landais double quasiment sa production, promoteur d’une « forêt cultivée », conçue pour compenser les facteurs limitants drastiques du milieu local.
-
Le tournant des années 2000
Au milieu du XXe siècle, d’importants dégâts, affectent les résineux plantés d’Europe : incendies des Landes (1949), attaques parasitaires récurrentes des pessières. De grandes tempêtes ébranlent les forêts, avec comme point d’orgue en France les ouragans Lothar et Martin en 1999 qui abattent trois années de récolte, suivis de Klaus en 2009. Au total, la moitié du massif aquitain est ravagée ! Les résineux payent un lourd tribut, par leur sensibilité propre, leur structure, ou par leur important volume sur pied, les peuplements monospécifiques et denses formant caisse de résonance à chaque aléa.
-
Le déplacement du débat, de la technique vers l’éthique
Ces déboires provoquent une intense réflexion autour d’une « sylviculture irrégulière à couvert continu et proche de la nature » s’inspirant du jardinage cultural du XIXe siècle : arbres traités individuellement en mélangeant tous les stades de développement au sein d’une même parcelle et suppression de la coupe rase.
Les tenants d’une monoculture simple et codifiée, soutenue par la demande industrielle, s’opposent alors à ceux d’une sylviculture « naturaliste », basée sur l’observation de l’écosystème forestier mais nécessitant une gestion fine, complexe pour le propriétaire. Au niveau de la parcelle, multifonctionnalité et spécialisation se heurtent, mais toujours dans le cadre d’une gestion durable, imposée par le Code forestier.
Vers 2010, la querelle se complexifie avec la montée en puissance des acteurs sociaux. Certaines associations, entraînant une partie de l’opinion publique, des médias et des élus, adoptent les thèses naturalistes mais souvent en les dépassant. La fonction de production de la forêt est minimisée, au nom d’une réappropriation de la nature par les citoyens. Les arbres sont considérés comme des êtres sensibles, voire intelligents, et apparaît la notion de « forêt en libre évolution ». Les plantations monospécifiques sont critiquées, avec en ligne de mire les résineux, notamment exotiques, symboles de l’artificialisation. Le rôle du forestier est remis en cause.
-
Où en est-on aujourd’hui ?
Le sylviculteur de résineux se trouve dans une situation très délicate. Si la fonction économique reste incontournable car seule capable de financer les travaux forestiers et de produire un matériau renouvelable et écologique, demandé par tous, elle ne peut plus cautionner tous les choix. La préservation des sols et de la biodiversité est reconnue comme essentielle pour la résilience des forêts. La fonction sociale, longtemps négligée, doit être prise en compte.
La sylviculture des résineux dans la tourmente des changements globaux
-
Le climat
Chacun connaît désormais l’importance et la rapidité du changement climatique. La forêt permet de l’atténuer en captant le carbone mais y est aussi vulnérable : augmentation des températures estivales et du stress hydrique, dépérissements… La mortalité a ainsi doublé en 10 ans. L’optimisation économique, sans être abandonnée, est dépassée par le souci de pérennité des peuplements.
Un des principaux enjeux de la foresterie du XXIe siècle est de réussir l’adaptation des forêts à cette évolution, a priori trop rapide pour que les arbres puissent y faire face, par la sélection naturelle et la migration. L’homme doit-il alors aider la nature ou la laisser s’adapter seule ?
-
Les invasions de bioagresseurs
Le développement d’épidémies peut rapidement décimer une essence. La forêt se trouve là attaquée de l’extérieur et de l’intérieur. Les entrées de bioagresseurs exotiques, souvent issus de l’importation de végétaux d’ornement, se multiplient au rythme exponentiel des échanges internationaux, malgré des mesures de surveillance draconiennes. On surveille, pour les résineux, les redoutables nématode du pin (présent au Portugal et en Espagne), chancre poisseux ou Phytophthora ramorum.
Mais certains parasites autochtones sont aussi susceptibles d’explosions épidémiques (scolytes en 2019-2023), potentialisés par la sécheresse (qui affaiblit les arbres) et par la température (qui facilite leur reproduction), donc par le changement climatique.
La résistance aux bioagresseurs est un second défi à relever.

Les dégâts inédits causés par le typographe de l’épicéa dans le Grand Est ont provoqué un choc et remis en cause la pérennité de l’essence, notamment en-dessous de 800 m d’altitude. Ces forêts avaient été ravagées pendant la guerre de 1914-1918. L’épicéa était apparu initialement comme une essence idéale, suffisamment rustique pour redonner vie à ces paysages lunaires sur des sols bouleversés ; mais l’évolution climatique en a décidé autrement…
Ne pas céder au pessimisme
Le sylviculteur a cependant beaucoup appris depuis 50 ans : comportement des essences, adaptation aux stations*, mécanismes de la croissance des arbres, fonctionnement des écosystèmes… Ces acquis doivent lui servir pour affronter une ère d’incertitudes. Il sait désormais qu’il n’y a pas de sylviculture miracle et que toute généralisation d’une option unique présente des risques sur le long terme.
Il semble donc que le maître mot doive aujourd’hui être « diversification », des essences, traitements, objectifs sylvicoles, révolutions… en constituant des forêts mosaïques formées de petites parcelles (1 à 5 hectares) faisant l’objet chacune d’un traitement différent, régulier ou non, sans a priori, susceptibles de diluer le risque tout en variant les paysages.
Philippe Riou-Nivert, spécialiste des résineux au CNPF-IDF, en retraite
* Station forestière : étendue de terrain homogène sur les plans du climat, du relief, du sol, de la végétation spontanée (source : CNPF).
CNPF-IDF : Centre national de la propriété forestière-Institut pour le développement forestier.
Ce texte est tiré d’extraits du livre Les résineux. Tome IV, que le CNPF-IDF vient de publier. Ce dernier volume de la collection « Les résineux » présente la diversité des sylvicultures applicables à ces essences. Pour chaque étape, plusieurs itinéraires sont décrits avec leurs avantages et contraintes, sans figer de doctrine, compte tenu du contexte mouvant actuel (changement climatique, risques sanitaires, demande sociétale…).
L’ouvrage, illustré et pratique, aide le forestier à conduire au mieux ses parcelles résineuses, en s’appuyant sur des décennies d’observations et d’expérimentations, mais en restant accessible. Un livre complet, indispensable pour les forestiers, les amateurs de résineux et ceux qui veulent les découvrir.
Plus de 500 photos, dessins, schémas et cartes.
740 pages, 16 x 24 cm. 55 euros.
Collection récompensée par l’Académie d’Agriculture de France (prix Clément Jacquiot 2016).